David Harvey, L’anticapitalisme au temps du COVID-19
Géographe et économiste, David Harvey a enseigné au département d'anthropologie de la City University of New York. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Les limites du capital » (éd. Amsterdam, à paraître en 2020), « Géographie de la domination. Capitalisme et production de l'espace » (éd. Amsterdam, 2018) et « Brève histoire du néolibéralisme » (Les Prairies ordinaires, 2014).
TRIBUNE. Pour le grand théoricien critique David Harvey, la crise économique mondiale déclenchée par l'épidémie de Covid-19 va conduire à l'effondrement de la forme de consumérisme sur laquelle repose le capitalisme néolibéral. Les seules voies de sortie possibles sont de type socialiste. Mais les oligarchies vont tout faire pour qu'elles soient « nationales-socialistes » plutôt que « populaires ».
Lorsque je veux interpréter, comprendre, analyser le flux des informations quotidiennes, j’ai tendance à situer ce qui arrive sur une toile de fond constituée de deux modèles, distincts mais en partie superposés, de fonctionnement du capitalisme.
Le premier modèle est une cartographie des contradictions internes à la circulation et à l’accumulation du capital, puisque la valeur monétaire, en quête de profit, passe par les différents « moments » (le mot est de Marx) que sont la production, la réalisation (ou consommation), la distribution et le réinvestissement. Ce modèle traite l’économie capitaliste comme une spirale sans fin d’expansion et de croissance. Il devient passablement compliqué à mesure qu’on l’élabore, parce qu’il faut y inclure un nombre croissant de facteurs : par exemple les rivalités géopolitiques, les développements géographiques inégaux, les institutions financières, les politiques publiques, les reconfigurations technologiques et le réseau, en permanente évolution, des divisions du travail et des rapports sociaux.
Mais ce modèle, tel que je l’envisage, s'insère plus largement dans le cadre de la reproduction sociale (au sein des ménages comme des communautés), dans un rapport métabolique permanent – et lui aussi en permanente évolution – à la nature (catégorie dans laquelle il faut inclure la « seconde nature » que constituent l’urbanisation et l’environnement bâti) et à toutes sortes de formations sociales culturelles, scientifiques (fondées sur la connaissance), religieuses et contingentes que les populations humaines créent généralement dans l’espace et dans le temps. Ces derniers « moments » incorporent l’expression active des besoins et des désirs humains, l’appétit de savoir et de sens et la quête évolutive d’accomplissement, sur fond d’arrangements institutionnels changeants, de contestation politique, de confrontations idéologiques, de pertes, de défaites, de frustrations et d’aliénations, le tout se déployant dans un monde caractérisé par une forte diversité géographique, culturelle, sociale et politique.

Ce second modèle constitue, en quelque sorte, ma grille d’intelligibilité opératoire du capitalisme mondial en tant que formation sociale particulière, tandis que le premier concerne les contradictions internes au moteur économique qui propulse cette formation sociale sur certaines voies d’évolution historique et géographique.
De l'épidémie à la crise généralisée : la spirale
Le 26 janvier 2020, quand j’ai lu le premier article traitant d’un coronavirus qui se propageait en Chine, j’ai immédiatement pensé aux répercussions à venir sur la dynamique globale de l’accumulation capitaliste. Je savais, grâce à mes recherches sur le modèle économique, que les blocages et perturbations de la continuité des flux de capital entraîneraient des dévalorisations et que, si ces dévalorisations allaient s’élargissant et s’approfondissant, elles seraient le signal d’un déclenchement de crise. J’avais aussi conscience du fait que, comme la Chine est la deuxième économie mondiale et qu’elle a sauvé le capitalisme global après 2007-2008, le moindre choc qu’elle subirait aurait nécessairement de graves conséquences sur une économie mondiale en piteux état. Le modèle existant de l’accumulation du capital était déjà, à mon sens, très mal en point. Presque partout, de Santiago à Beyrouth, étaient apparus des mouvements de contestation, dont beaucoup étaient centrés sur le fait que le modèle économique dominant ne fonctionnait pas pour la majeure partie de la population. Ce modèle néolibéral repose de plus en plus sur le capital fictif, c’est-à-dire sur une énorme expansion de l’offre de monnaie et de la création de dette. Il est déjà confronté au problème d’une demande effective insuffisante pour réaliser les valeurs que le capital est capable de produire. Alors comment ce modèle économique dominant, à la légitimité chancelante et à la santé délicate, pourrait-il absorber l’impact inévitable d’une pandémie potentielle et comment pourrait-il y survivre ? La réponse dépend très largement de la durée de la perturbation, car, comme Marx l’a souligné, les dévalorisations se produisent non pas parce que les marchandises ne peuvent pas se vendre, mais parce qu’elles ne peuvent pas se vendre à temps.
Je refuse depuis longtemps l’idée d’une « nature » extérieure et séparée de la culture, de l’économie et de la vie quotidienne. Je nourris une conception plus dialectique et relationnelle du rapport métabolique à la nature. Si le capital modifie les conditions environnementales de sa propre reproduction, il le fait dans un contexte marqué par des conséquences non-intentionnelles (comme le changement climatique) et sur fond de forces autonomes et indépendantes, en évolution, qui transforment en permanence les conditions environnementales. De ce point de vue, il n’existe pas de catastrophe réellement naturelle. Certes, les virus mutent constamment. Mais les circonstances dans lesquelles une mutation de cet ordre en vient à menacer la vie humaine dépendent des actions humaines. Deux aspects concernent le sujet qui nous occupe.

Tout d’abord, des conditions environnementales favorables accroissent la probabilité de mutations virulentes. Il est ainsi plus que plausible qu’une transformation rapide, intensive et incontrôlée de l’habitat et des chaînes alimentaires, par exemple dans les zones humides subtropicales, y contribuera. Ce genre de système existe à de nombreux endroits, notamment en Chine, au sud du Yang-Tsé, et en Asie du Sud-Est. Ensuite, il existe une grande variété de conditions propices à une transmission rapide via des organismes hôtes. Une forte densité de population humaine en fait manifestement partie. Il est connu que les épidémies de rougeole, par exemple, ne se développent que dans de grands centres urbains et s’éteignent rapidement dans les régions à faible densité de population. La manière dont les êtres humains interagissent et se déplacent, leur discipline ou leur négligence en matière d’hygiène ont une incidence sur la transmission des maladies.
Ces dernières décennies, le SRAS, tout comme les grippes aviaire et porcine, semblent être nés en Chine ou en Asie du Sud-Est. La Chine a beaucoup souffert des fièvres porcines au cours de l’année passée, ce qui a entraîné une destruction massive des élevages et une hausse des prix du porc. Je ne dis pas cela pour pointer un doigt accusateur sur ce pays. Dans de nombreux autres endroits, les risques environnementaux propices à la mutation et à la propagation du virus sont élevés. La grippe espagnole de 1918 est peut-être venue du Kansas ; l’Afrique a peut-être incubé le VIH et elle est sans doute le point d’origine du virus du Nil occidental et d’Ébola ; tandis que la dengue semble prospérer en Amérique latine. Toujours est-il que l’impact économique et démographique lié à la dissémination du virus dépend de failles et de vulnérabilités préexistantes du modèle économique hégémonique.
L’un des travers de la mondialisation réside dans l’impossibilité d’empêcher la diffusion rapide de nouvelles maladies à l’échelle internationale.
Je n’ai pas été surpris outre mesure d’apprendre que le Covid-19 est d’abord apparu à Wuhan (bien que l’on ignore si c’est là qu’il trouve son origine). Il était évident que cela aurait d’importants effets à l’échelle locale et, comme il s’agit d’un grand centre de production, des répercussions économiques mondiales étaient probables (mais j’ignorais quelle en serait l’ampleur). La grande question était la suivante : comment la contagion et la propagation du virus allaient-elles se développer, et combien de temps cela allait-il durer (jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin) ? L’expérience a montré que l’un des travers de la mondialisation réside dans l’impossibilité d’empêcher la diffusion rapide de nouvelles maladies à l’échelle internationale. Dans notre monde hyperconnecté, tout un chacun, ou presque, voyage. Les réseaux humains de propagation potentielle sont immenses et ouverts. Le danger (économique et démographique) était que la perturbation dure un an ou plus.
Certains cercles de l’administration Trump se sont réjouis de ce que le virus porte un coup à une croissance chinoise dont rien, autrement, ne semblait pouvoir contrarier le rythme arrogant.
Si la nouvelle du virus entraîna immédiatement et partout dans le monde une baisse des actions, elle fut suivie, étonnamment, de hausses record pendant un mois environ. Les informations dont on disposait semblaient indiquer que l’activité économique se poursuivait normalement partout, sauf en Chine. On paraissait croire que l’on allait avoir une réédition du SRAS, dont la propagation fut assez rapidement endiguée, avec un faible impact mondial, malgré son fort taux de mortalité et la panique (rétrospectivement) injustifiée qu’il suscita sur les marchés financiers. Lorsque le Covid-19 est apparu, la réaction dominante a donc consisté à considérer l’affolement comme inutile. Le fait que l’épidémie ait frappé la Chine, qui a rapidement pris des mesures drastiques pour en contenir les effets, a aussi porté le reste du monde, à y voir, à tort, un problème de « là-bas », loin des yeux donc loin de l’esprit (avec d’inquiétantes manifestations de xénophobie antichinoise dans certaines parties du monde). Certains cercles de l’administration Trump se sont même réjouis de ce que le virus porte un coup à une croissance chinoise dont rien, autrement, ne semblait pouvoir contrarier le rythme arrogant. Le bruit commençait à courir, cependant, que les chaînes globales de production passant par Wuhan étaient interrompues. On ignora ces informations dans une large mesure et, quand on en tint compte, on considéra les problèmes comme limités à des produits ou des entreprises spécifiques (comme Apple). Les dévalorisations n’étaient pas systémiques, mais localisées et particulières. On a minimisé aussi les signes de baisse de la demande du côté des consommateurs, même si les multinationales, comme McDonald’s ou Starbucks, qui avaient de gros intérêts dans le marché intérieur chinois, ont dû fermer boutique dans le pays pendant un temps. Tout au long du mois de janvier, le début de l’épidémie a été masqué par la coïncidence avec le Nouvel An chinois. Cette attitude présomptueuse était complétement hors de propos.

Quarante ans de néolibéralisme en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ont laissé les populations totalement vulnérables et impréparées à une crise sanitaire de ce type
Au départ, on n’a eu qu’une perception sporadique de la diffusion internationale du virus : un foyer sérieux en Corée du Sud, quelques autres points chauds, comme l’Iran. C’est le début de l’épidémie en Italie qui a déclenché la première réaction violente. Le krach boursier qui a débuté mi-février a conduit à la mi-mars, après quelques oscillations, à une dévalorisation de près de 30 % des bourses mondiales. L’augmentation exponentielle des cas d’infection a suscité un éventail de réponses, souvent incohérentes et parfois marquées par la panique. Face à la perspective d’une potentielle vague ascendante de malades et de décès, le président Trump s’est essayé à une imitation de Knut le Grand – ce roi qui, selon la légende médiévale, se vantait d’être capable d’arrêter la marée grâce à ses pouvoirs surnaturels. Certaines réactions furent pour le moins étranges. Par exemple, il semblait bizarre que, pour faire face au virus, la Réserve fédérale abaisse ses taux d’intérêt, même si cette décision était destinée à apaiser les marchés, non à endiguer l’épidémie. Presque partout, les autorités publiques et les systèmes de santé ont été pris de court. Quarante ans de néolibéralisme en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ont laissé les populations totalement vulnérables et impréparées à une crise sanitaire de ce type, même si la peur suscitée par le SRAS et par Ébola avaient constitué de gros avertissements et livré des enseignements sur la conduite à adopter. Dans de nombreuses parties du monde supposé « civilisé », les gouvernements locaux et les autorités régionales/d’État, qui forment invariablement la ligne de front défensive en situation d’urgence sanitaire et sécuritaire, ont été privés de financements par des politiques d’austérité conçues pour financer les baisses d’impôt et les subventions en faveur des grandes entreprises et des riches.
La prévention ne crée pas de valeur pour l’actionnaire. C’est plutôt le contraire. L’application du modèle de l’entreprise à la gestion de la santé publique a éliminé le surplus de capacités de traitement nécessaire en cas d’urgence.
Les géants de l’industrie pharmaceutiques n’ont que peu ou pas d’intérêt à mener des recherches non lucratives sur les maladies infectieuses (telles que celles provoquées par la famille des coronavirus, bien connus depuis les années 1960). « Big Pharma » investit rarement dans la prévention. Il n’a pas vraiment d’intérêt à investir dans la préparation aux crises sanitaires. Ce qu’il aime, c’est concevoir des remèdes. Plus nous sommes malades, plus il gagne d’argent. La prévention ne crée pas de valeur pour l’actionnaire. C’est plutôt le contraire. L’application du modèle de l’entreprise à la gestion de la santé publique a éliminé le surplus de capacités de traitement nécessaire en cas d’urgence. La prévention n’était même pas un domaine d’activité assez alléchant pour justifier des partenariats public-privé. Le président Trump a réduit le budget du CDC (le Centre de Contrôle des Maladies, qui concentre aux États-Unis l’équivalent des structures françaises comme l’INSERM, le CNRS, l’Institut Pasteur, etc.) et dissout le groupe de travail sur les pandémies du Conseil de Sécurité Nationale, dans l’esprit qui l’a conduit à diminuer tous les financements de la recherche, y compris sur le changement climatique. Si je voulais adopter un point de vue anthropomorphique et métaphorique sur la situation, je conclurais que le Covid-19 est la revanche prise par la Nature sur quarante années de grossière maltraitance qui lui ont été infligées par un extractivisme néolibéral violent et dérégulé.
Le fait que Trump ait traîné pendant de nombreuses semaines se révélera presque à coup sûr très coûteux en vies humaines.
Il est peut-être symptomatique que les pays les moins néolibéraux, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, s’en tirent pour l’instant mieux que l’Italie, même si le cas de l’Iran contredirait l’universalité de ce principe. De nombreux éléments montrent que la Chine a assez mal géré le SRAS, en jouant au départ la carte de la dissimulation et du déni ; mais cette fois-ci, le président Xi a rapidement promu la transparence aussi bien pour le signalement des cas que pour les tests, comme l’a fait la Corée du Sud. Malgré cela, la Chine a perdu un temps précieux (dans ce genre de situation, une poignée de jours font toute la différence). Il est cependant remarquable qu’elle soit parvenue à contenir l’épidémie dans la province du Hubei, au centre de laquelle se trouve Wuhan. L’épidémie ne s’est pas propagée avec la même cruauté à Pékin, ni à l’ouest, ni même plus au sud. Fin mars, la Chine a annoncé l’absence de nouveau cas dans le Hubei et Volvo le retour à la normale de sa production dans le pays, alors que le reste de l’industrie automobile mondiale s’arrêtait. Les mesures prises pour circonscrire le virus géographiquement furent larges et restrictives (comme la situation l’imposait). Elles seraient difficile à reproduire ailleurs pour des raisons politiques, économiques et culturelles. Les informations venant de Chine suggèrent que les traitements et les mesures mis en œuvre ont été tout sauf doux pour la population. En outre, la Chine et Singapour ont déployé leurs capacités de surveillance des individus à des niveaux invasifs et autoritaires. Mais, dans l’ensemble, ces pays semblent avoir été d’une grande efficacité, bien que – les modélisations le laissent penser – si de telles réponses avaient été mises en œuvre quelques jours plus tôt seulement, un grand nombre de décès auraient été évités. C’est une information importante : dans tout processus de croissance exponentielle, il y a un point d’inflexion au-delà duquel la masse en augmentation devient totalement incontrôlable (on notera ici, une fois de plus, l’importance du ratio masse-taux). Le fait que Trump ait traîné pendant de nombreuses semaines se révélera presque à coup sûr très coûteux en vies humaines.

À présent les effets économiques se développent en spirale incontrôlable à travers le monde entier. Les perturbations à l’œuvre dans les chaînes de valeur des grandes entreprises et de certains secteurs s’avèrent plus systémiques et substantielles qu’on ne le pensait au départ. À long terme, ce processus pourrait avoir pour effet de raccourcir ou de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de favoriser des formes de production moins intensives en force de travail (avec d’énormes implications pour l’emploi) et plus dépendantes de l’intelligence artificielle. La perturbation des chaînes de production entraîne la mise au chômage partiel ou total des travailleurs, ce qui fait diminuer la demande finale, tandis que la baisse de la demande en matières premières entraîne la diminution de la consommation productive. À eux seuls, ces effets du côté de la demande auraient au moins produit une légère récession.
L’énorme armée de travailleurs de la « gig economy », l’économie des petits boulots, ou d’autres secteurs du précariat se retrouve sur le carreau sans disposer de moyens de subsistance visibles.
Mais c’est ailleurs que se trouvent les principaux points de vulnérabilité. Les types de consumérisme qui ont explosé après la crise de 2007-2008 se sont effondrés, avec des conséquences catastrophiques. Ils reposaient sur la réduction du temps de rotation de la consommation, de façon à le faire tendre autant que possible vers zéro. L’afflux d’investissement est allé de pair avec l’absorption maximale de volumes de capital en croissance exponentielle dans ces formes de consumérisme caractérisées par les temps de rotation les plus courts possibles. Le tourisme international était emblématique à cet égard. Entre 2010 et 2018, le nombre de déplacements touristiques internationaux est passé de 800 millions à 1,4 milliards. Ce genre de consumérisme « expérientiel » instantané a nécessité des investissements massifs dans les infrastructures : aéroports et lignes aériennes, hôtels et restaurants, parcs à thème et événements culturels, etc. Ce lieu d’accumulation du capital est désormais déserté, les compagnies aériennes sont au bord de la faillite, les hôtels sont vides et le secteur de l’hôtellerie sera bientôt frappé par le chômage de masse. Manger dehors n’est pas une bonne idée ; restaurants et bars ont été fermés dans de nombreux endroits. Même la vente à emporter semble dans une situation précaire. L’énorme armée de travailleurs de la « gig economy », l’économie des petits boulots, ou d’autres secteurs du précariat se retrouve sur le carreau sans disposer de moyens de subsistance visibles. Les événements de toutes sortes sont annulés : festivals culturels, compétitions de football ou de basket, concerts, congrès professionnels, et même les rassemblements politiques liés aux élections. Ces formes événementielles de consumérisme expérientiel sont supprimées. Les recettes des administrations locales s’effondrent. Les universités et les écoles ferment.
D’une partie du monde à l’autre, la spirale de l’accumulation sans fin du capital s’effondre de l’intérieur.
Dans les conditions actuelles, le modèle avancé du consumérisme capitaliste contemporain n’est, dans une large mesure, plus opératoire. La tendance à ce qu’André Gorz appelle le « consumérisme compensatoire » (où les travailleurs aliénés sont censés se régénérer grâce aux vacances organisées sur une plage des tropiques) est sérieusement mise à mal. Or les économies capitalistes actuelles reposent à 70 ou 80 % sur le consumérisme. La confiance et le moral des consommateurs constituent, depuis quarante ans, la clé de la mobilisation de la demande effective et le système du capital est de plus en plus fondé sur la demande et les besoins. Cette source d’énergie économique n’a jusqu’à présent pas connu de fortes fluctuations (à quelques exceptions près : ainsi avec l’éruption volcanique en Islande qui a entraîné l’arrêt des vols transatlantiques pendant deux semaines en avril 2010). Le Covid-19, cependant, implique non pas une fluctuation violente, mais un effondrement total de la forme de consumérisme qui domine dans les pays les plus riches. D’une partie du monde à l’autre, la spirale de l’accumulation sans fin du capital s’effondre de l’intérieur. La seule chose qui soit susceptible de la sauver serait que les États financent et suscitent une reprise artificielle de la consommation de masse. Aux États-Unis, par exemple, cela impliquerait de socialiser l’ensemble de l’économie sans donner à cette mesure le nom de socialisme. En tout cas, c’en est fini du scepticisme général de la population quant au besoin d’un État doté de vastes pouvoirs ; on s’accorde de plus en plus largement à reconnaître qu’il y une différence entre les gouvernements et qu’il en existe de bons. L’assujettissement des États aux intérêts des détenteurs d’actifs et des financiers (comme c’est le cas depuis 2007-2008) apparaît être une mauvaise idée, y compris pour la finance.
Aux États-Unis, la classe ouvrière (majoritairement composée d’Africains Américains, de Latinos et de femmes) est confrontée à un horrible choix : soit la contamination, soit le chômage sans indemnités (et donc sans accès aux soins de santé adéquats).
Les lignes de front
Un mythe bien commode veut que les maladies infectieuses ignorent les barrières et frontières sociales, de classe ou autres. Comme beaucoup d’autres mythes, celui-ci contient une part de vérité : l’épidémie de choléra qui fit rage au XIXe siècle parvint si bien à transgresser les barrières de classe qu’elle entraîna la naissance d’un mouvement d’hygiène et de santé publique, lequel s’est professionnalisé par la suite pour perdurer jusqu’à ce jour. Ce mouvement était ambigu, au sens où il était parfois difficile de savoir s’il visait à protéger tout un chacun ou les seules classes supérieures. Toujours est-il qu’aujourd’hui, la différenciation des effets sociaux de la maladie présente un autre tableau.

Les impacts économiques et sociaux sont filtrés par les discriminations « habituelles » que l’on constate partout. Pour commencer, la force de travail qui est censée s’occuper du nombre croissant de malades se trouve fortement genrée, racialisée et ethnicisée dans la majeure partie du monde. Elle est en cela identique à la force de travail que l’on trouve par exemple dans les aéroports et les autres secteurs logistiques. Cette « nouvelle classe ouvrière » est en première ligne : c’est elle qui a le plus grand risque de contracter le virus au travail et c’est elle aussi qui court le plus risque de se retrouver au chômage, sans la moindre ressource, à cause du ralentissement économique l’activité imposé par le virus.
La progression du Covid-19 présente toutes les caractéristiques d’une pandémie inégalement répartie selon la classe, le genre et la race.
Se pose notamment la question de savoir qui peut et qui ne peut pas travailler à la maison. Cette distinction accentue le social, tout comme la division entre ceux qui peuvent se permettre de s’isoler ou de se mettre en quarantaine (en étant payés ou non) en cas d’infection ou de contact avec une personne contaminée. J’ai été amené à dire ailleurs que les tremblements de terre au Nicaragua (1973) et à Mexico (1985) avaient été des « tremblements de classe ». De la même manière exactement, la progression du Covid-19 présente toutes les caractéristiques d’une pandémie inégalement répartie selon la classe, le genre et la race. Les tentatives de l’endiguer ont beau s’envelopper dans le beau discours du « Nous sommes tous dans la même galère », les pratiques, de la part des gouvernements nationaux en particulier, laissent penser à de plus sinistres motivations. Aux États-Unis, la classe ouvrière (majoritairement composée d’Africains Américains, de Latinos et de femmes) est confrontée à un horrible choix : soit la contamination, au nom du soin et du maintien d’activités essentielles d’approvisionnement (alimentaire, par exemple), soit le chômage sans indemnités (et donc sans accès aux soins de santé adéquats). Le personnel salarié (dont je fais partie) travaille chez soi et reçoit sa paie exactement comme avant, tandis que les PDG se déplacent en jet privé et en hélicoptère. Dans la majeure partie des pays du monde, les travailleurs sont de longue date socialisés pour se conduire en bons sujets néolibéraux (ce qui signifie qu’ils s’en prennent à eux-mêmes ou à Dieu si les choses tournent mal, sans surtout jamais oser se demander si ce ne serait pas le capitalisme le problème). Mais aujourd’hui, même les bons sujets néolibéraux constatent que quelque chose cloche dans la gestion de cette pandémie.
Les cygnes sont revenus dans les canaux de Venise.
La grande question est : combien de temps cela va-t-il durer ? Plus d’un an, peut-être ; et plus cela durera, plus la dévalorisation sera forte, y compris pour la force de travail. Le niveau du chômage augmentera probablement à un niveau comparable à celui des années 1930 si les États n’interviennent pas de façon massive – et en contradiction avec la fibre néolibérale. Cette situation a de multiples implications immédiates pour l’économie et pour la vie sociale au quotidien. Toutes, cependant, ne sont pas mauvaises.

Dans la mesure où le consumérisme était excessif, il tendait vers ce que Marx appelle une « hyperconsommation et une consommation démente qui, qui, sous des formes monstrueuses et extravagantes, marque le déclin » du système tout entier. L’excès de cette consommation débridée a joué un rôle majeur dans la dégradation environnementale. L’annulation des vols internationaux, la réduction drastique des transports et des déplacements ont des conséquences positives en matière d’émissions de gaz à effet de serre. La qualité de l’air s’est nettement améliorée, à Wuhan comme dans de nombreuses villes des États-Unis. Les sites écotouristiques vont avoir un moment pour se remettre de l’incessant piétinement qu’ils subissaient jusqu’ici. Les cygnes sont revenus dans les canaux de Venise. Dans la mesure où un frein sera mis au consumérisme débridé et insensé, il pourrait y avoir un certain nombre d’effets bénéfiques de long terme. Moins de morts sur l’Everest, ce serait une bonne chose. Et, bien que personne n’ose le dire tout haut, le biais démographique créé par le virus pourrait finir par affecter les pyramides des âges, avec des effets de long terme sur la charge représentée par la sécurité sociale et sur le futur de l’« industrie du soin ». Le rythme de la vie quotidienne va ralentir et ce sera, pour certains, une bénédiction. Si l’urgence dure assez longtemps, les règles de distanciation sociale qui sont promues pourraient conduire à des transformations culturelles. La seule forme de consumérisme expérientiel qui tirera presque à coup sûr un bénéfice, c’est ce que j’appelle l’économie « Netflix », qui subvient en toute situation aux besoins des spectateurs compulsifs.
Ironie ultime : les seules orientations qui soient susceptibles de fonctionner sont bien plus socialistes que tout ce que Bernie Sanders aurait pu proposer, et c’est sous l’égide de Donald Trump que ces mesures de sauvegarde devront être mises en œuvre.
Quant aux réponses sur le front économique, elles ont été conditionnées par l’Exode, en quelque sorte, qu’a déclenché le krach de 2007-2008 : une politique monétaire ultra-laxiste combinée à un sauvetage des banques, le tout complété par un accroissement spectaculaire de la capacité productive grâce à l’expansion massive de l’investissement dans les infrastructures en Chine. Ce dernier processus ne peut être réitéré à l’échelle requise. Les plans de sauvetage mis en œuvre en 2008 se sont concentrés sur le secteur bancaire ; mais ils ont aussi impliqué la nationalisation de fait de General Motors. Il est peut-être significatif que, face à la colère ouvrière et à l’effondrement de la demande, les trois grandes compagnies automobiles de Detroit aient fermé, au moins pour le moment.
Si la Chine ne peut jouer à nouveau le rôle qu’elle a tenu en 2007-2008, alors c’est sur les États-Unis que se trouve déplacée la charge de sortir le monde de la crise économique en cours. Et c’est là que réside l’ironie ultime : les seules orientations qui soient susceptibles de fonctionner, aussi bien au plan économique qu’au plan politique, sont bien plus socialistes que tout ce que Bernie Sanders aurait pu proposer, et c’est sous l’égide de Donald Trump, sans doute sous le masque du « Make America Great Again », que ces mesures de sauvegarde devront être mises en œuvre. Tous les Républicains qui étaient viscéralement opposés au sauvetage de 2008 seront contraints, soit de manger leur chapeau, soit de défier Donald Trump. Ce dernier invoquera probablement l’urgence pour annuler les élections et déclarer le commencement d’une présidence impériale destinée à sauver le capital et le monde entier des émeutes et de la révolution. Si les seules politiques efficaces sont de type socialiste, il est hors de doute que l’oligarchie aux commandes fera tout son possible pour qu’elles soient nationales-socialistes plutôt que populaires-socialistes. L’anticapitalisme a pour tâche de l’empêcher. •••
Traduit de l'anglais pour Le Média Presse par Nicolas Vieillescazes.
Une première version de ce texte, ici augmentée, est parue le 20 mars 2019 sur le site web du magazine états-uniens Jacobin.
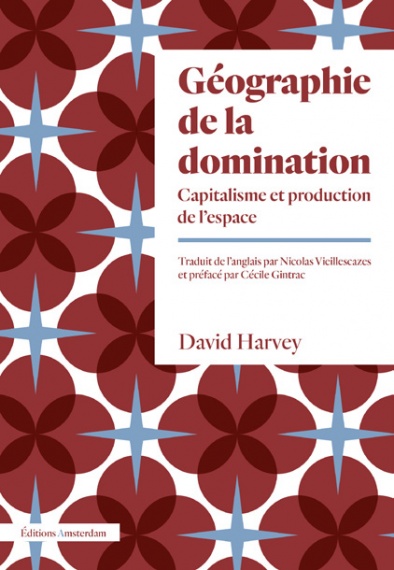
Belvidere, Illinois (Etats-Unis), 24 mars 2020. Parking clairsemé d'une usine Chrysler. Crédit : AFP.